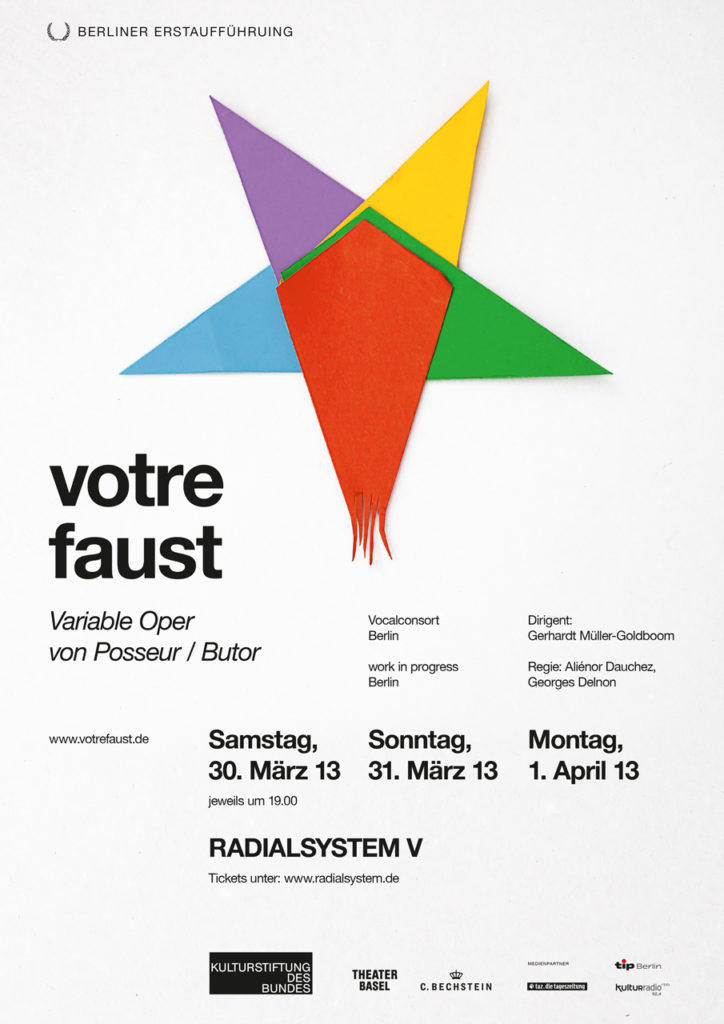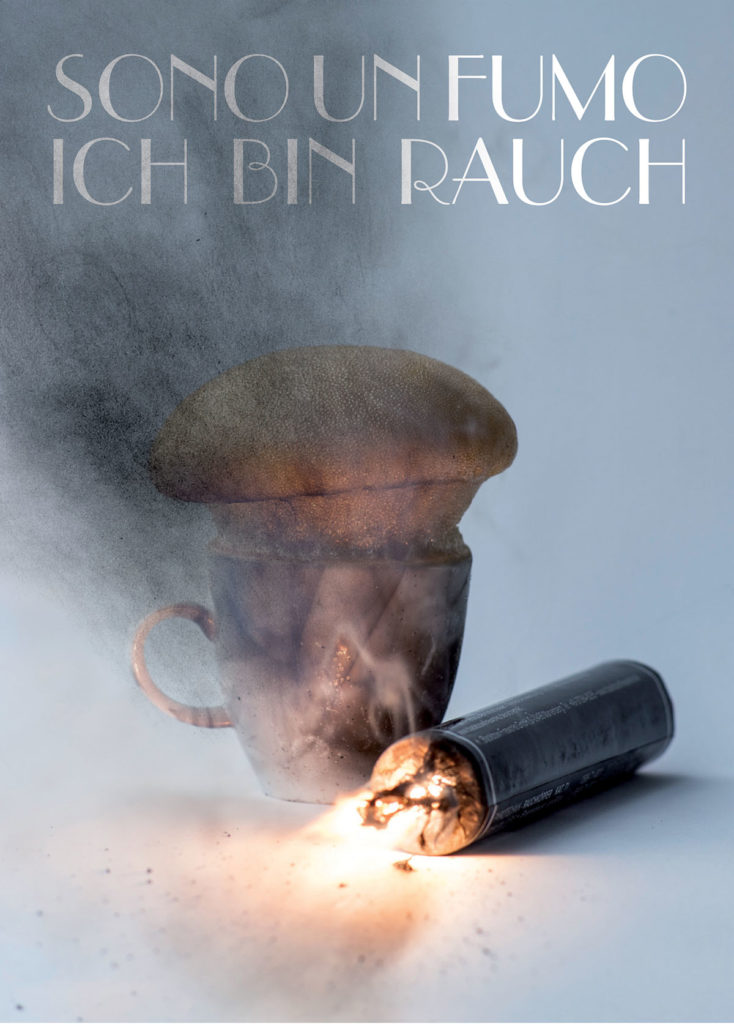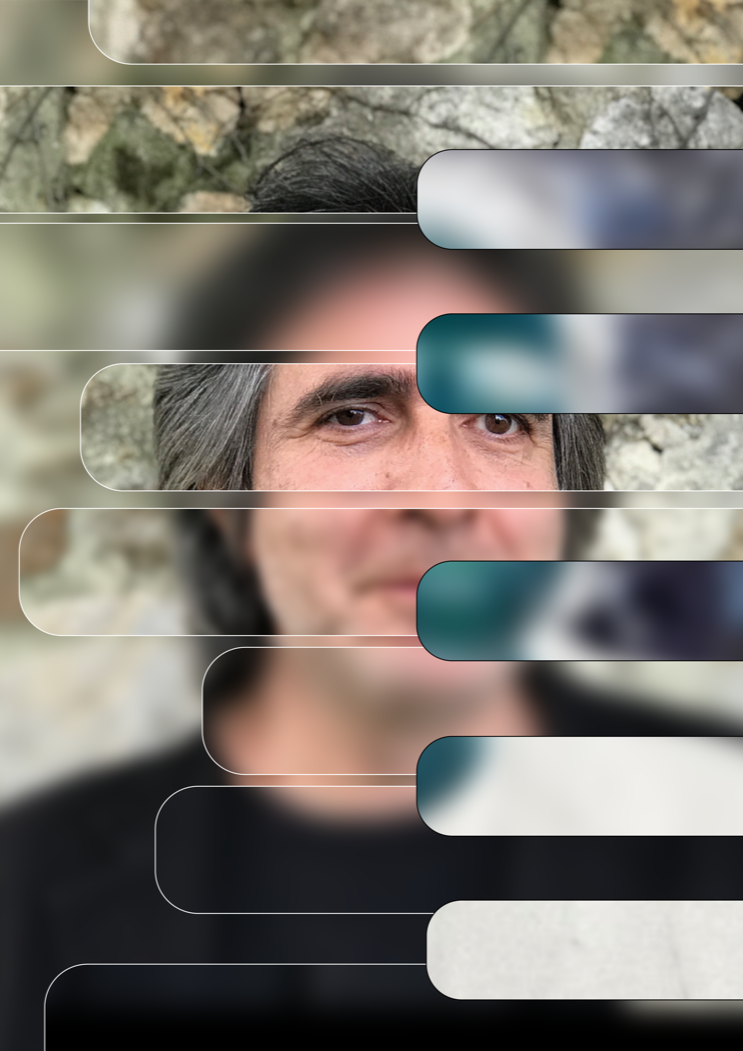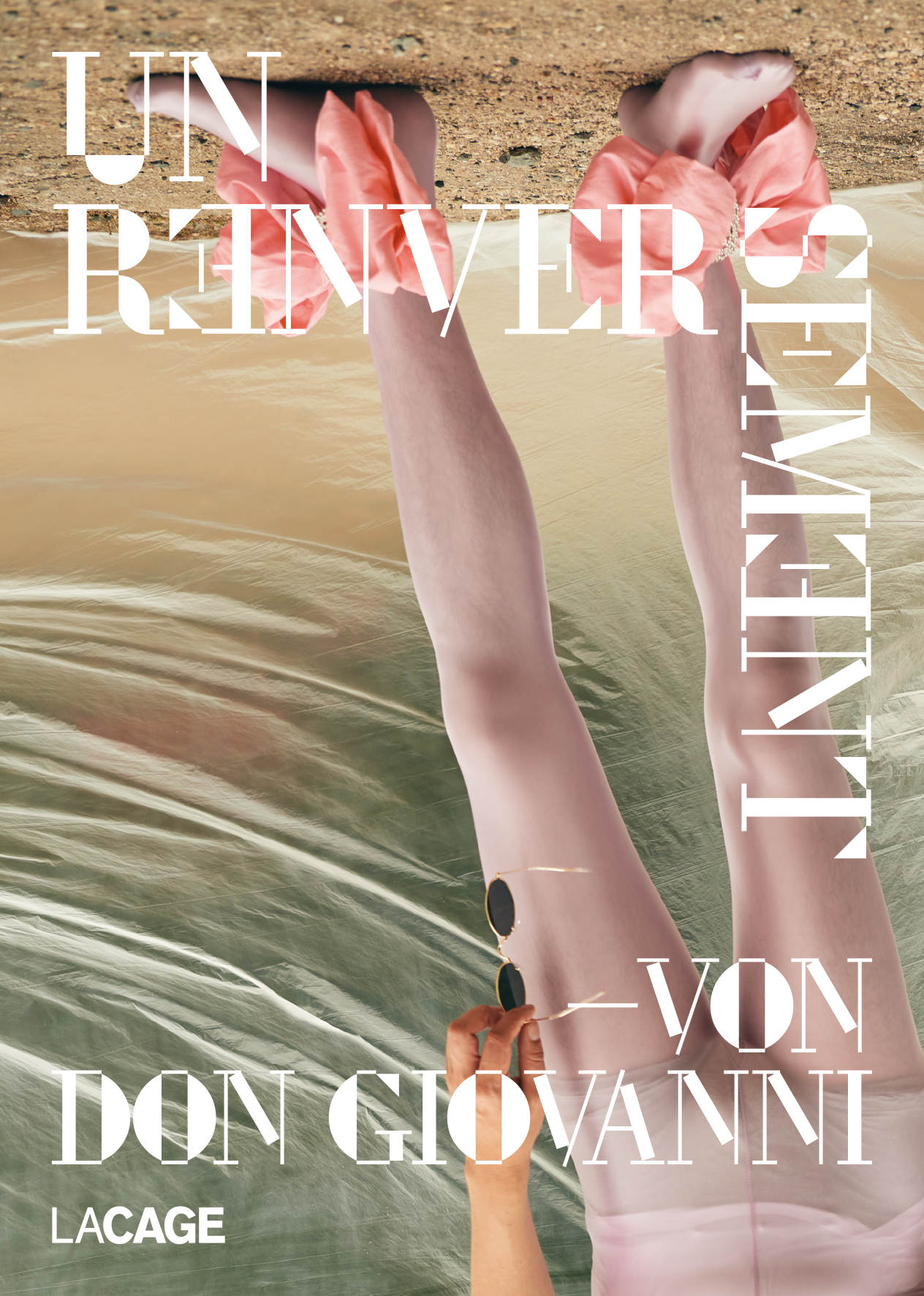In Between – Narcisse
Casting >>
Direction musicale : Matthias Pintscher
Mise en espace : Aliénor Dauchez, Michael Kleine
Musique : Beat Furrer, Yves Chauris, Brice Pauset, Pierre Boulez, Yann Robin
Assistanat : Cassandra Cristin, Cécilia Franco
Parfum : Georg Scherlin
Photos : Quentin Chevrier
2021
Cité de la musique, salle des concerts
Coproduction Ensemble intercontemporain, Philharmonie de Paris
En partenariat avec l’Ircam – Centre Pompidou et La Cage
Ce concert a reçu le soutien de la Sacem
Narcisse, c’est un mythe curieusement très « formel », d’un point de vue à la fois sonore et visuel, qui a notamment inspiré de nombreux chefs-d’œuvre dans l’histoire de la peinture. C’est aussi un mythe largement opérant dans le domaine de la psychologie, puisqu’il a trait à l’amour-propre. Mais, comme bien des mythes, l’histoire ne fait que poser un cadre : quiconque s’en empare peut l’emmener dans une direction qui lui est propre. On ne sait par exemple pas que Narcisse est né du viol de sa mère…